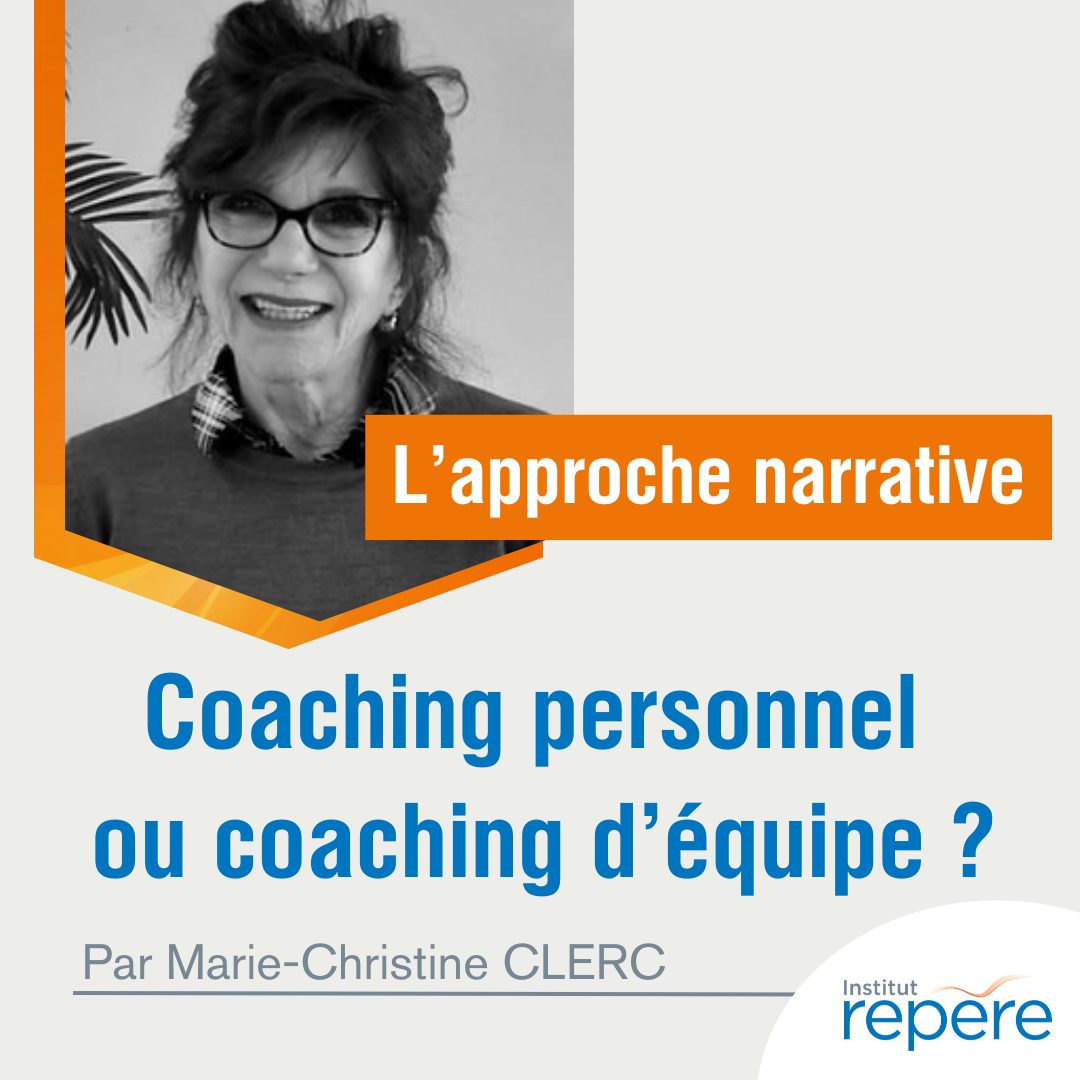Coaching personnel ou coaching d’équipe ?
C’est au cours d’un « speed coaching » avec une classe de BTS étiquetée « redoutable », que j’ai pris conscience de la réelle compétence de l’approche narrative pour le coaching des groupes ou des équipes.
Face à des élèves en rupture totale de motivation et une équipe pédagogique en menace de décrochage, j’ai vu, en 3 sessions de 2 heures, les conflits se diluer ; la déléguée de classe dont les comportements étaient vécus comme autocrates a demandé pardon au groupe, pendant que d’autres créaient un fast-food solidaire dans l’école dans le but de financer un projet commun. Tous n’étaient pas concernés mais tous ont joué le jeu. Le travail a repris un rythme acceptable vers l’examen, ce qui n’est pas rien.
Les stagiaires de l’Institut Repère le demandent souvent : l’approche narrative est-elle adaptée au management des équipes et au travail avec les groupes ? Alors qu’elle est le plus souvent présentée comme un outil du coaching identitaire sur des problématiques individuelles. Cette approche permet en effet un travail à un très haut niveau logique (valeurs-croyances-identité), pour résoudre par exemple des situations de sentiment d’échec personnel au travail, de perte de sens, de solitude du manager, ou d’inanité de l’effort. Ce qui d’ailleurs lui a permis d’acquérir sa grande renommée dans le contexte du coaching bref.
Les problèmes et leur externalisation, fondement de l’approche narrative
L’approche narrative en collectif se fonde comme le coaching individuel sur la démarche de l’externalisation. C’est une méthode douce et « écologique » : elle permet d’aller dans les plaintes sans crainte de s’y perdre. L’intention est d’amener les personnes à contredire eux-mêmes les conclusions identitaires négatives qu’ils profèrent. En un mot, à retourner le problème rapidement sur lui-même.
Un des principes de l’approche est que « le problème est le problème, la personne n’est pas le problème « (M. White) et « la solution ne dépend pas que de soi », ajoute D. Denborough. Externaliser le problème en parlant de lui en « il », c’est créer un espace entre soi et le problème, c’est séparer la personne ou le groupe de son problème, et ainsi retrouver de la force pour agir sur lui. Externaliser c’est exprimer par la métaphore comment il nous a recrutés dans ses stratégies et comment il nous fait penser, ressentir et faire tout un tas de choses, alors que nous pensions en être les responsables ; c’est aussi le déplacer d’un espace centré sur la personne vers le champ collectif.
Répartis en sous-groupes avec rapporteurs, les étudiants ont d’abord réfléchi à ces questions « d’externalisation ». Quelques extraits :
- Comment nommeriez vous le problème qui agit dans votre classe ?
- Comment s’y prend il ? comment est-il né ? (alliés, mode opératoire, …)
- De quoi a t’il besoin pour continuer à polluer votre vie ?
- Quels effets a t’il à votre sur vos relations entre vous ? Avec les profs ? sur la façon dont les autres voient votre classe ? quelle image vous renvoie-t-il de vous-même ?
- Quels effets a t’il sur votre travail ? sur quoi d’autre ? Diriez vous que ce sont des effets toxiques ? ou pas ?
- Que ressentez vous quand vous pensez à son influence ? comment vivez vous cela ?
Et des réponses :
- Le problème est nommé : un fléau, un panier de crabes, un loup, une sangsue, du goudron, du gaz, de la dope, …
- Ce « poison » a besoin pour survivre de leur complicité, du silence, de lâcheté, de violence, de défaitisme, de mauvaise foi, …
- La situation est « pourrie », invivable, elle leur échappe ; ils se sentent rejetés, exclus, ils ne se reconnaissent pas ; ils sont devenus mesquins, déprimés, …
Cette opération « vide-sac » permet en général de prendre en grippe le problème, de l’épuiser, en le considérant pour ce qu’il est, c’est-à-dire une contrainte, et non comme l’expression d’une pathologie. Elle permet d’ouvrir des pistes vers les exceptions ; les valeurs et ressources exprimées alors ravivent des expériences et des valeurs qui n’ont pas leur place dans l’histoire de la plainte.
L’implicite du problème
C’est le deuxième grand principe de l’approche : le fameux retournement, fondé sur la notion « d’absent implicite ». Ce terme désigne simplement ce qui contredit le problème. C’est ce qui n’est pas là et qui manque quand le problème est là : par exemple, la solitude renvoie par contraste à l’appartenance, la contrainte à l’autonomie, ou la violence au respect. Être abattu ou démotivé, c’est encore une façon d’agir, de dire non, de refuser quelque chose dans sa vie ou même de se rebeller.
- De quoi ça vous coupe quand « Sangsue » est là ? Qu’est-ce qu’elle empêche ?
- Et quand vous dites non à Sangsue, à quoi dites vous oui ?
- Pourquoi n’êtes – vous pas d’accord avec l’influence toxique de « Sangsue » ?
Et des réponses :
- Le problème les empêche de travailler, les coupe de leur identité vraie, de la confiance, du plaisir d’être étudiants, d’être ensemble, de la considération des profs, du respect, de la solidarité, de l’ambition, d’être traités en adultes, de retrouver du leadership dans l’école, …
- Ils ne sont pas OK avec « Sangsue » car on ne les aime pas, alors qu’ils se pensent sympathiques, fêtards, attentifs aux autres, généreux, impatients de travailler en agence et de gagner de l’argent, …
Le travail narratif s’est ensuite poursuivi avec des outils complémentaires pour réactiver l’espoir jusqu’à la mise en place d’objectifs possibles et d’initiatives responsables.
Au commencement était le groupe
Au tout début de l’approche narrative en Australie dans les années 80, Michael White et David Epston à qui l’on avait confié des groupes d’enfants aborigènes en situation de mal-être intense, ont inventé l’art de leur faire raconter collectivement leurs propres histoires réparatrices, celles de leur culture. Alors qu’aucun de ces deux travailleurs sociaux n’avaient la moindre idée de comment les aider. Plus près de nous, David Denborough, investi dans le traitement des traumas dans les communautés humaines, renoue avec les origines collectives de cette approche. Et créé de nouvelles « cartes » de travail en collectif, comme le célèbre Arbre de vie. Avant eux, c’est M. Mead et G. Bateson, à l’aube des recherches sur la communication et le contexte, qui écoutent les récits des groupes et la façon dont les conflits sont traités collectivement dans des cultures différentes.
Au-delà du dilemme
Au plus loin de l’alternative « outil de coaching individuel ou d’équipe », David Denborough nous rappelle qu’en narrative les récits sont doubles :
- Tout d’abord, il ne s’agit pas seulement d’écouter les plaintes, mais dans le même temps, de révéler comment la personne ou le groupe a réagi pour faire face à ses difficultés. Comment il s’est protégé, avec quelles ressources, intentions, aides, engagements, rêves ou espoirs : c’est un principe central de la méthode.
- D’un autre côté, traiter
les problématiques personnelles n’est jamais simplement traiter une question individuelle. Pour M. White la vie personnelle est profondément enracinée dans le social. Les histoires singulières que nous racontons décrivent également les effets qu’ont sur nous des problèmes collectifs plus larges ; ou permettent que d’autres récits puissent exister. L’actualité en témoigne : récits de mal-être au travail, de violences, de discriminations …
Approche narrative : les outils
Des outils conceptuels et méthodologiques ont été pensés afin que les deux voix (soi et la part sociale) puissent co-exister et produire des récits alternatifs.
Ainsi à l’Institut Repère, nous formons en dehors de « la carte du problème » (brièvement illustrée dans l’exemple ci-dessus), à plusieurs autres « cartes », afin de donner une vision suffisante de l’approche :
- La carte des exceptions : la voie courte pour sortir d’une situation de plainte et en redevenir auteur.
- La carte du « remembering » pour reconnecter la ou les personnes à un monde où les relations sont plus coopératives, et traiter les sentiments de solitude professionnelle, de perte ou d’épuisement.
- La carte du « re-telling », typiquement collective, créé des résonnances en groupe entre les narrations des personnes en présence pour ancrer de nouvelles histoires riches.
L’approche narrative c’est toujours comment raconter notre histoire de façon qu’elle nous rende plus fort. On n’est jamais les seuls à vivre ce qui nous arrive, nous dit M. White. En accompagnement individuel, l’approche remet la personne en lien avec les autres ; en collectif elle nourrit l’identité individuelle de chacun grâce aux échanges.
Pour en savoir plus découvrez la Formation animée par Marie-Christine Clerc à l’Institut Repère : Accompagner avec l’Approche Narrative
Pour tous les métiers de l’accompagnement et du soin, mangement, facilitateurs des processus de groupe (forum ouvert, co-développement), médiation, négociation, gestion des conflits, pédagogues, éducateurs spécialisés, aide sociale à l’enfance, …
Ne manquez aucun article de nos formatrices et formateurs experts et recevez leurs coups de cœur, conseils et recommandations, en vous abonnant à Repérages, la lettre d’information mensuelle de l’Institut Repère